L’ancien fleuron sidérurgique des Pays-bas, tombé en disgrâce à cause de son activité polluante, continue de faire battre le cœur de ses salariés. Plus de 100 ans après sa création, ils défendent ardemment l’usine Tata Steel, et avec elle, leurs emplois et une partie de leur histoire familiale.
Une coulée de lave orange jaillit subitement des entrailles du haut-fourneau n°6. Le volcan de l’aciérie, qui culmine à 125 mètres de hauteur, entre en éruption. Arnold Vogelaar recule de surprise. Les deux mains agrippées à son téléphone, il filme le spectacle.
« Imaginez tout ce qui est fabriqué grâce à cet acier chez vous : les piles, les radiateurs, les réfrigérateurs et les voitures. Retirez tout ça et vous verrez qu’on serait encore tous assis par terre », commente en criant l’ex-salarié de 69 ans, des bouchons anti-bruit vissés aux oreilles. Après quarante-huit ans de carrière à Tata Steel, située à l’ouest d’Amsterdam, il en fait volontairement la visite, ce lundi de février.

En face de lui, un bras de fer automatisé, surplombé d’une foreuse à l’aspect rugueux, vient de percer un large trou vertical dans le ventre du fourneau. « Comment les gens qui travaillent là ne pourraient pas avoir mal au coeur quand ils entendent que leur usine pollue ? Nous sommes très fiers de ce que nous faisons », fulmine Arnold Vogelaar, le visage rougi par la chaleur étouffante, désormais happé par la dextérité d’un fondeur.
Au milieu de l’immense entrepôt rouillé par l’oxydation du fer, Job Bakker paraît minuscule. La figure noircie par les poussières de charbon, il manie aussi bien des marteaux que des machines de plusieurs tonnes. Visser, percer, boucher, vider : ici, on répète inlassablement les mêmes gestes depuis sept heures, au chevet de la fournaise capable de cracher 9 tonnes d’acier à la journée.
« Il y a du bruit, du feu, des fumées, il fait chaud. C’est un métier pour les bosseurs qui n’ont pas froid aux yeux, s’emballe l’hyperactif de 25 ans, qui a couvert son casque de chantier de plusieurs dizaines de stickers. Une goutte de sueur perle sur son front. Mes potes me disent que c’est sale, qu’ils viennent voir un peu ! ». Job pointe du doigt une hotte géante de forme rectangulaire, et une seconde, à la caractéristique d’être mobile, censées l’empêcher d’inhaler les fumées des métaux brûlés.


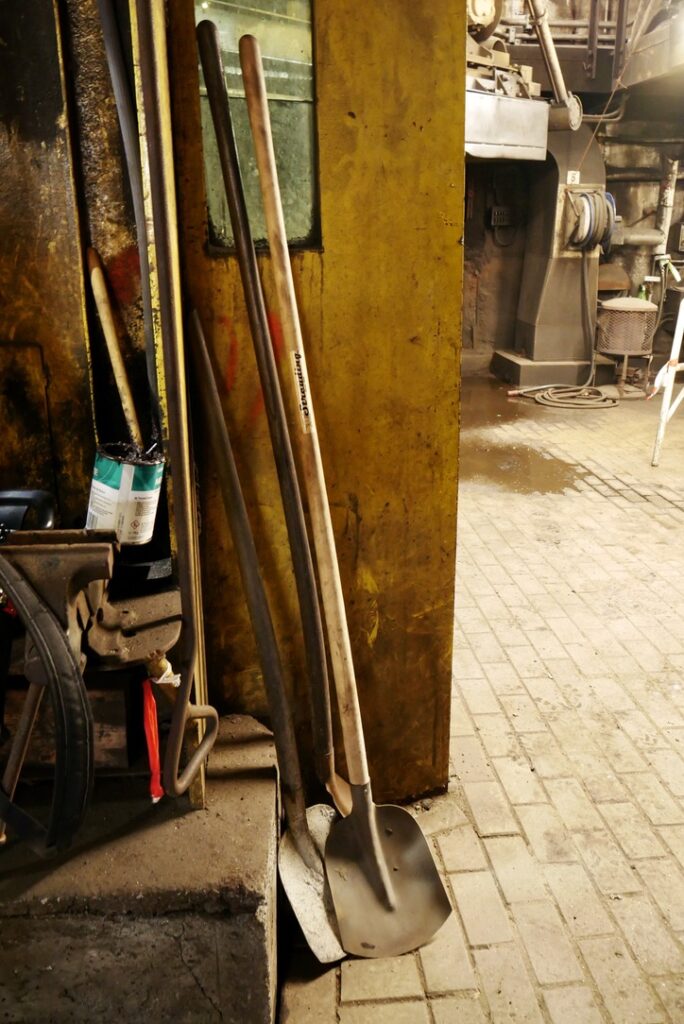
L’acier vert, la solution Tata Steel
Depuis plus d’un siècle, l’histoire glorieuse de l’entreprise – historiquement appelée Koninklijke Hoogovens – coule dans les veines des ouvriers. La production de fonte puis d’acier, célébrée en grande pompe par la famille royale en 1926, a contribué d’un même geste à l’enrichissement du pays et celle de ses salariés. Premières vacances, accès aux études et à la propriété : les familles ouvrières ont pu s’émanciper grâce à l’ancien fleuron industriel et lui sont restées fidèles, quitte à fermer les yeux sur son activité polluante.
Pourtant, les faits sont là. La cokerie rejette des métaux lourds y compris du plomb qui nuisent à la santé de ses 9 000 salariés et des riverains. Le taux de cancer des poumons est jusqu’à 50% supérieur à la moyenne nationale dans certaines régions périphériques, selon une étude publiée par l’IKNL, l’institut de cancérologie des Pays-bas en 2020.
En réponse, la branche néerlandaise de la multinationale indienne Tata Steel a annoncé un ambitieux plan pour produire de l’acier vert et réduire ses émissions de CO2 de 35 à 40% d’ici à 2030. Une transformation au coût estimé à plusieurs milliards d’euros, prévoyant de produire de l’acier à partir d’hydrogène, au lieu du gaz naturel actuellement utilisé.
« L’un de nos deux hauts fourneaux a été remis en marche début février après des mois d’arrêt sans que personne s’en aperçoive à l’extérieur. La dernière fois, en 2002, les fumées avaient été senties jusqu’à 50 kilomètres du site », explique Lenne Bakker, ingénieure qui a suivi la modernisation de l’infrastructure, datant de 1967.



En juin dernier, une centaine de militants de Greenpeace et d’Extinction Rébellion se sont introduits dans l’enceinte du site afin d’en bloquer l’accès aux salariés. Des prises de position anti-Tata qui inquiètent – certains confient avoir désactivé leur compte Facebook depuis – et qui sont de « de moins en moins raisonnables » selon Jack Gerritsen, opérateur de maintenance.
Quand il était enfant, sa tante essuyait avec ses doigts la suie amassée sur la corde à linge avant d’étendre ses vêtements à l’extérieur. Cinquante ans plus tard, ces poussières brunâtres sont incrustées partout dans l’enceinte de l’usine : aux pneus des voitures, aux façades en briques et aux fenêtres des bâtiments pré-fabriqués. Il y a six ans, une nuit d’hiver, une pluie de graphite et de neige noire a même été soufflée par les cheminées sur la région. Le père de famille n’avait jamais vu ça.
Un avenir incertain, à défendre coûte que coûte
« Nous avons dormi trop longtemps ici. Il faut que nous progressions pour l’environnement mais je doute qu’on y parvienne en si peu de temps », admet Jack avec pudeur, aujourd’hui âgé de 60 ans, assis au bord de son fauteuil à roulettes. Depuis une salle de contrôle à l’allure de cockpit, équipée d’une kitchenette à la mode des années 1980, il surveille la composition des métaux introduits dans le haut-fourneau.
Le père de famille, qui vient tous les jours au travail à vélo, n’est pas le seul à douter. En novembre dernier, la direction a annoncé un plan de licenciement de 800 personnes, alors qu’elle rencontre des pertes financières sans précédent. Une « décision prise dans l’urgence » que réprouve le groupement syndical FNV, qui compte près de 4 500 adhérents – soit la moitié des effectifs du groupe.

« La direction doit prouver aux employés que leur carrière à Tata Steel est assuré sur cinq à dix ans, avance Cihan Lacin, le secrétaire général du syndicat. Licencier des gens n’est pas la solution quand on sait que nous manquons déjà de personnel pour engager la transition vers de l’acier propre. Tata Steel ne pourra pas continuer d’exister sans eux ».
Si les critiques existent bel et bien, elles ne se partagent qu’entre salariés, à l’intérieur de l’usine. Ces derniers prennent soin de ne pas écorner son image et forment un bloc uni derrière le géant d’acier. Les récentes polémiques engendrées par la pollution ont même participé à forger un discours partagé de tous, à commencer par Arnold Vogelaar : « Ce n’est pas parfait, on le sait bien, mais on fait de notre mieux ».
Le journaliste néerlandais Bart Vuijk, récompensé pour ses recherches sur l’aciérie, a pu observer la sensibilité du sujet lorsqu’il a publié ses premières investigations dans le journal Noordhollands Dagblad. « J’ai reçu de nombreuses menaces du personnel ces dernières années. Certains ont dit qu’ils viendraient chez moi pour me frapper. Leur loyauté envers l’entreprise n’est plus à prouver », concède-t-il lors d’un entretien téléphonique.
Une histoire glorieuse en héritage
Défendre l’usine quand elle est attaquée, c’est d’abord protéger une part de son identité. De son port au large de la mer du Nord à son portail vitré orné de feuilles d’or par l’architecte Dudok, les salariés travaillent chez Tata Steel comme dans un village autonome avec ses règles et ses traditions. La transmission de ce savoir-faire métallurgique de père en fils en est une.
« Mon grand-père et mon père ont travaillé ici, je travaille ici depuis vingt-cinq ans et mes deux garçons travailleront ici aussi. Avec eux, mon héritage se perpétuera », raconte fièrement Frenk Groen, chef opérateur dans les hauts fourneaux, accoudée à une table en formica blanc. Les fils Groen, âgés d’une vingtaine d’années, suivront les pas de leurs aïeuls à la « Tata Academy », où sont formés la majorité des employés depuis 85 ans.



Pour les descendants d’ouvriers sensibles aux enjeux climatiques, la mémoire de cet héritage charrie son lot d’interrogations. « Comment aborder les problèmes de l’usine à la maison tout en respectant l’attachement de nos proches à leur histoire ? », résume Matthew Kunst*, ancien éditorialiste, assis à la table d’un bar branché du centre-ville de Beverwijk, à cinq minutes en voiture de Tata Steel. Le trentenaire se rappelle de longues conversations parfois conflictuelles avec son père, son frère ou ses cousins, qui y travaillent.
L’année dernière, la metteuse en scène Christine Otten et sa fille se sont librement inspirées de son vécu pour écrire leur pièce de théâtre. Dans « Sous la fumée des hauts fourneaux, un drame familial mouvementé », elles imaginent l’histoire d’une famille déchirée par le sort de l’usine : le père la défend coûte que coûte, tandis que le fils la dénigre. Matthew et son père ont assisté ensemble à l’une des représentations, dans la grande salle à la décoration défraîchie du « Hoogovens Museum », à l’entrée du site.

« L’ambiance était tendue au début. J’avais peur que mon père déteste ce qu’il avait vu », raconte d’un ton lent Matthew, qui puise dans ses souvenirs. À la fin, il m’a dit que les gens devaient savoir tout ça. Que des changements doivent intervenir chez Tata Steel mais qu’il faut aussi respecter et prendre en considération l’opinion des salariés ».
Au terme d’une visite de quatre heures, notre guide pose sa mallette grise sur une table du musée. Il a revêtu une chemisette bleue brodée d’un fourneau en fusion. « Il y a autant d’êtres humains que de façons de voir les choses, réplique Arnold Vogelaar sans grand enthousiasme, à propos de la pièce de théâtre. Le futur de Tata Steel ne s’écrira qu’à la lumière du passé. Les gens ne peuvent pas comprendre l’importance de l’usine ». Las, le retraité ressasse une gloire passée, mais l’avenir ici reste incertain.
* : le prénom a été modifié



